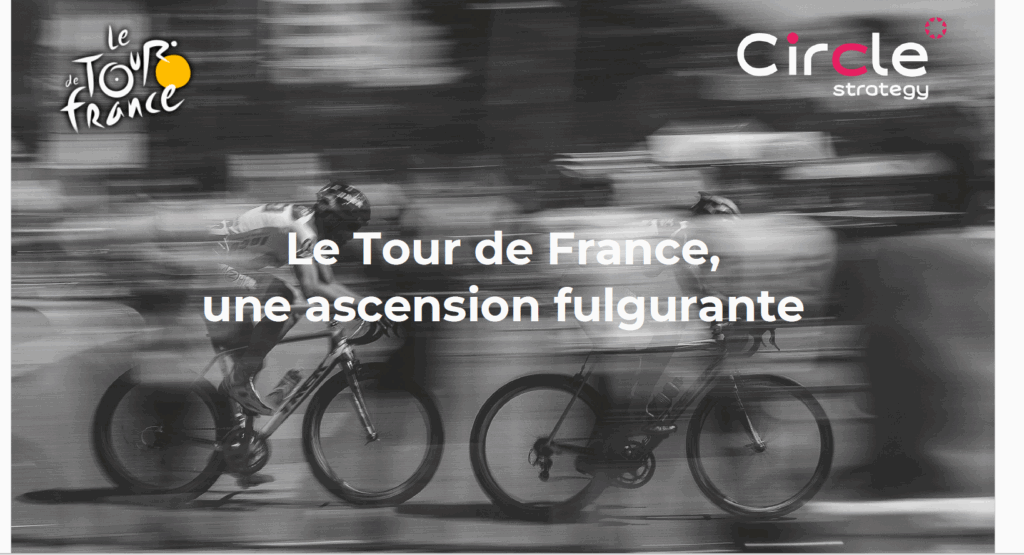Protéger et/ou prendre des risques en 2025 ?
« Protéger, risquer. Quels équilibres ? » Organisées par la Ville de Neuilly et l’Institut Sapiens début février, avec le soutien des cabinets de conseil Circle Strategy et Square Management, les Rencontres des Sablons ont fait intervenir plus de 30 think tanks et dirigeants autour de ce thème d’une parfaite actualité.
Dans un contexte de crises multiples et imbriquées – géopolitique, énergétique, politique et économique –, la tentation d’un surcroît de régulation et de précaution peut s’avérer aussi dangereuse que l’absence de garde-fous. Entre la nécessité de garantir une souveraineté et l’urgence de stimuler la prise de risque, les débats ont mis en lumière les leviers d’action pour l’Europe et la France. Quelles leçons en tirer pour la suite ?
Protéger sans risquer, un déséquilibre très européen
L’Europe s’essouffle depuis plusieurs années, sclérosée dans un excès de protection et de précaution. Pour la plupart des intervenants, le diagnostic est sans équivoque. « Avec les attentats terroristes, les crises économiques et les catastrophes naturelles se créée une culture de la peur. La peur du risque devient tellement importante qu’elle crée une culture de l’évitement, qui infantilise nos sociétés. » Augustin de Romanet, Président-directeur général du groupe Aéroports de Paris, identifie ceci comme une crise de la responsabilité. Sous perfusion d’aides de l’Etat providence, la société européenne perd le sens du leadership, tandis que la responsabilité individuelle s’atrophie.
De surcroit, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a remis l’ordre européen en cause. La crise énergétique en est un symptôme criant. « En 2022, l’Europe passe d’une logique d’abondance à une logique d’instabilité du gaz et de l’électricité, devenus des commodités », explique Laurence Poirier-Dietz, Directrice générale de GRDF.
L’heure est au sursaut. « L’élection de Trump et la brutalité de Poutine sont un ‘wake-up call’ salutaire. L’Europe a toujours eu des réticences à exercer sa puissance, mais le sursaut est nécessaire. Elle doit se réarmer politiquement, militairement, technologiquement et économiquement », d’après Bernard Emié, ancien Directeur Général de la Sécurité Extérieure (DGSE). Le rapport Draghi remis en septembre 2024 alerte sur un défi existentiel : l’Europe doit digitaliser son économie, la décarboner et développer ses capacités de défense, au risque de perdre sa raison d’être.
Protéger, certes, mais risquer davantage, sans hésiter : l’appel à une autonomie européenne
Comment l’Europe peut-elle retrouver sa puissance ? Il s’agit de repenser sa réglementation afin de faciliter la compétition, de favoriser la montée de grands champions européens et de stimuler l’innovation. Cela passe par un meilleur équilibre : protéger, mais moins, et risquer davantage.
Protéger l’Europe, c’est cultiver un espace économique souverain. Pourquoi s’empêcher de favoriser nos entreprises sur les marchés européens ? Le rapport Draghi propose des mesures préférentielles afin de sécuriser les intérêts européens dans des secteurs clés comme celui de la défense, de renforcer les chaînes d’approvisionnement locales et de réduire ainsi nos dépendances.
Risquer, c’est libérer l’activité économique pour favoriser l’innovation et la compétition. Pour stimuler le financement de l’innovation, pourquoi ne pas penser un capital-risque français aussi audacieux que le venture capital américain ? Alléger la régulation des banquiers et assureurs pourrait leur permettre de retrouver leur rôle et de faciliter la prise de risque au sein de l’écosystème des start-ups. L’Europe accuse un retard sur les technologies de pointe, notamment l’IA. Ce n’est qu’en innovant qu’elle pourra anticiper pour industrialiser les technologies clés de demain.
Risquer, c’est aussi oser investir massivement dans l’autonomie énergétique de l’Europe. L’Europe dispose par exemple d’un fort potentiel de production de biométhane et d’hydrogène vert. L’indépendance énergétique de l’Europe passera par de nouvelles infrastructures, un effort de compétitivité du gaz vert par rapport au gaz fossile et par la digitalisation de la production, comme l’a rappelé Isabelle Poirier-Dietz.
Dans cette poursuite d’un modèle de croissance vertueux et durable, risquer n’est pas tout abandonner. Toute transition est progressive, a précisé Hervé Varillon, Directeur général de Crédit Agricole Leasing & Factoring : « Dans une transition, on parle d’aller d’un point A à un point B. Il ne faut pas oublier que cela ne se fait pas d’un claquement de doigt. On ne peut pas abandonner du jour au lendemain des solutions qui nous étaient indispensables, ce serait le chaos total. »
Enfin, le sursaut doit être français. Face à un système social complexifié à l’extrême par la volonté de tout protéger, plusieurs réformes pourraient être poursuivies, telles que celles de l’assurance chômage, la taxe du travail, la réduction des dépenses publiques, etc. La France a besoin d’un sursaut culturel, selon Gabriel Attal, ancien Premier ministre : « Nous devrions retrouver les grandes épopées collectives de notre pays. Notre génération n’a pas de grande épopée en tête. Elle n’a été révolutionnée que par le smartphone, qu’on ne peut pas attribuer à la France. »
Les Rencontres des Sablons ont offert un éclairage précieux aux participants, dirigeants et citoyens sur le dilemme entre protection et prise de risque, mettant en évidence des choix stratégiques nécessaires pour l’avenir de l’Europe. Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine en a conclu que chaque renoncement aujourd’hui représente un retard sur les grands enjeux de demain, qu’il s’agisse d’innovation, d’autonomie énergétique ou de souveraineté économique. Le progrès repose sur une prise de risque maîtrisée et assumée.
Il en va de même pour les entreprises. Les dirigeants français et européens se doivent d’oser prendre davantage de risques, notamment en période d’incertitudes et de turbulences des marchés, tout en assurant la protection ajustée de leurs intérêts stratégiques, financiers, et opérationnels. C’est cet équilibre délicat, cette ligne de crête, que nous aidons nos clients dirigeants à trouver.
À l’Europe et à la France d’oser à nouveau !